Pour la solidarité, Contre L'exclusion
portrait de militante
« Je ne suis pas née féministe, je le suis devenue »
Hedwige Peemans-Poullet est une infatigable militante et analyste des droits des femmes, en particulier de leurs droits sociaux. Pourtant, elle est devenue féministe assez tardivement, un peu « par hasard », après une première partie de parcours elle-même émaillée d’accidents, fâcheux parfois, heureux souvent…

Hedwige Peemans-Poullet n’est pas une inconnue de nos lectrices et lecteurs. Nous avons plusieurs fois fait appel à elle pour porter une analyse féministe sur les projets d’allocation universelle et de revenu de base. (1) Car Hedwige, dont la carrière professionnelle a été principalement consacrée au journal des Mutualités chrétiennes En Marche (rien à voir évidemment avec le mouvement de Macron, ce journal porte ce nom depuis sa création le 15 mai 1948), est une figure marquante du féminisme en Belgique et l’une de celles qui s’est sans doute la plus intéressée aux questions de la Sécurité sociale en général et des droits des femmes dans notre système de protection sociale en particulier. Avec une formation d’historienne qui lui a permis de remonter plusieurs fois aux origines (réelles) des enjeux ou des mesures. Une raison de plus évidemment de lui consacrer une place de choix dans notre rubrique « Portrait de militant-e ». La richesse de son parcours nous fera le présenter en deux épisodes dont voici le premier, de sa naissance en 1933 jusqu’à « l’entrée en féminisme ».
Ensemble ! Dans cette rubrique, nous essayons de comprendre comment est né puis s’est développé l’engagement militant. Comment cela s’est-il passé pour vous ?
Hedwige Peemans-Poullet : Ce qui est clair, c’est que durant la première partie de ma vie, je n’ai jamais interprété mes échecs ou mes difficultés de manière féministe. Donc je ne peux pas dire que j’ai toujours été féministe. Il faut bien comprendre que, quand j’étais jeune, le féminisme n’était pas une évidence. Aujourd’hui les jeunes femmes peuvent directement mettre le nom « féminisme » sur ce qui leur arrive.
Toutes ne le font pas pour autant !
Certes, mais c’est disponible, ce qui n’était pas le cas quand je suis entrée dans l’âge adulte…
Vous évoquiez des échecs ?
J’ai eu une période assez moche dans ma vie de famille, entre plus ou moins 18 et 28 ans. Une période que je considère comme ayant conduit à une perte d’identité personnelle qui est liée en partie au déménagement de mes parents vers Liège après la guerre. Jusque-là j’habitais Bruxelles, où j’étais élève à la Vierge fidèle. Cette perte d’identité personnelle est liée en partie aussi avec le fait que dès la 3ème ou 4ème latine, j’ai eu la conviction absolue que j’étais faite pour étudier l’histoire et pour enseigner. Donc j’avais une vocation, quelque chose qui m’allait bien. Malheureusement, pendant longtemps, mes parents ont freiné cette vocation en pensant agir pour mon bien. De cette période-là, je retiens comment on peut subir une perte d’identité, une perte de conscience de soi que j’ai retrouvée chez beaucoup de copines à partir de leur mariage. Donc je sais comment cela peut arriver, comment l’on peut être mise sous pression.
Comment est-ce que vous vous sortez de cette emprise ?
Grâce à mon frère qui a été dire à mes parents : « Mais enfin si elle a envie de faire l’histoire, laissez-lui faire l’histoire ». Je parviens donc finalement (et tardivement, en 1961 seulement, donc dix ans après ma sortie de secondaires) à m’inscrire en histoire à l’UCL. A ma grande surprise, on n’y accepte pas de valoriser les cours de mes candidatures à Liège. Je dois donc refaire les quatre années. A partir de là, tout va très bien, je réussis et dès la fin de mes études, je suis invitée à remplacer un assistant (en histoire du Moyen-Âge). Puis je reçois trois contrats à durée déterminée (trois fois deux ans) pour faire ma thèse.
C’est volontairement que vous commencez le récit de votre parcours à partir de 18 ans sans parler de la période antérieure ?
Mon enfance ? Je suis issue d’un milieu social confortable, pas riche mais très confortable, reconnu, de la petite aristocratie… Mon père étant militaire de carrière, il a un traitement de fonctionnaire, mais pas de capital personnel. J’ai une enfance relativement heureuse, sans problème. Quand je suis née, mes parents habitaient à Bruxelles, avenue Coghen, mais, considérant que la maison était trop petite, ils sont venus s’installer avenue de l’Armée, également pour que mes frères puissent aller à pied au collège Saint-Michel. Alors que moi je n’ai pas été à l’école jusqu’à mes neuf ans environ.
Vous étiez instruite à la maison alors ?
Oui ma mère m’a appris à lire et à écrire. Elle utilisait un petit livre qui s’appelait « Riri a ri ». J’ignore si elle faisait les démarches nécessaires pour prouver que j’étais instruite à la maison ni pourquoi j’avais un régime différent de mes frères. Rien ne me prédisposait à devenir féministe. Dans mon enfance j’étais une petite maman à poupées !
Vous êtes née en 1933. Donc vous avez connu la guerre et l’occupation…
Oui bien sûr. Mon père, militaire de carrière, est fait prisonnier et envoyé en Allemagne. Ma mère décide alors d’aller habiter avec ses cinq enfants chez mes grands-parents Belpaire, toujours à Bruxelles. Honnêtement, c’était un paradis terrestre, ils avaient en pleine ville un demi-hectare de jardin avec tous les fruits et légumes possibles et imaginables. Sans doute que ma mère remettait tous les timbres de ravitaillement des enfants à ma grand-mère pour gérer les achats extérieurs mais nous avons vécu très confortablement, sans privation.
Au sortir de la guerre, vous avez donc douze ans…
Oui et c’est un peu après la fin de la guerre que commence ma période difficile. Mon père a quitté l’armée et a trouvé un boulot à Liège. Au début il a fait la navette mais ils ont pour finir acheté une maison à Liège, assez charmante, au bord de l’eau. La première année où je me suis retrouvée là, j’ai dû aller chez les Bénédictines. Ce fut l’horreur et le début de la perte d’identité. A la fois parce que les cours étaient épouvantables et que je n’avais pas de contacts sociaux (j’avais évidemment perdu toutes mes copines de Bruxelles). Ensuite, mes parents ont freiné de tous les moyens possibles et imaginables pour que je n’aille pas à l’Unif : j’ai dû prendre des cours de coupe-couture à Seraing, des cours d’anglais, de la sténo-dactylo, etc. Pour finir j’ai pu aller à l’ Unif mais… en sciences politiques à Liège. Et comme cela ne me convenait pas, j’ai mal fait, et mes parents étaient tout à fait confortés dans leur opinion : « C’est ce qu’on disait, voilà, elle n’est pas capable d’aller à l’Unif ».
Et c’était une attitude qu’ils avaient spécifiquement avec vous et pas avec vos frères ?
Mes frères n’ont pas eu les mêmes oppositions. Mais je ne le vivais pas comme cela, je ne l’ai pas éprouvé comme cela. Je ne l’ai compris que plus tard. J’en ai fait une interprétation avec laquelle mon frère n’était d’ailleurs pas d’accord. J’ai dit à mon père que je voulais devenir professeur d’histoire. Or son père et son arrière-grand-père furent de grands professeurs renommés d’histoire à l’UCL Pour lui c’était le sacrilège absolu que je veuille marcher sur leurs traces. Et il m’a dit d’un air super méprisant : « Vous n’allez pas devenir une de ces abominables institutrices à lunettes ». Mais je n’ai jamais demandé à devenir institutrice ! Cette phrase me reste gravée en mémoire à jamais. Mon frère Édouard a connu quelque chose du même genre mais il ne l’a pas vécu de la même manière. Il travaillait très mal en primaire et mes parents ont fini par l’amener chez un psy et le psy lui a dit : « Mais vous voulez faire quoi plus tard ? » et il a dit « Moi je vais devenir ministre ». Ministre comme qui ? Comme le grand-père ! Et là aussi mon père était furieux, c’était un sacrilège, etc.
C’est bizarre parce qu’il aurait pu en être fier a contrario ?
Je ne veux pas faire des interprétations rétrospectives en fonction des lectures que j’ai faites ensuite.

Comment avez-vous pu braver ces interdits familiaux ?
J’ai voulu quitter Liège et suis retournée vivre chez mes grands-parents à Bruxelles. Je donnais des cours particuliers de rattrapage à la Vierge fidèle. Un jour, une religieuse du Berlaymont s’est adressée à moi pour me demander de créer une section de modernes en économie familiale. Il y avait déjà une section modernes en langues et les parents qui avaient des enfants qui ne réussissaient pas dans cette section ne voulaient pas devoir enlever leurs enfants de l’école. Et cette religieuse m’a très honnêtement dit : « Le diplôme que vous avez et qui peut fonctionner comme régente maintenant ne sera plus valable après. » Donc si la section était ensuite reconnue, il faudra disposer du diplôme exigé à ce moment-là. Donc pour moi le diplôme d’histoire. Et c’est à ce moment-là que Édouard est intervenu en disant : « Elle a bien le droit quand même de faire les études universitaires qu’elle voulait ! ». Et là mes parents ont cédé. Je commence enfin l’histoire en 1961, à vingt-huit ans.
Pendant ces années d’études, vos parents vous dotent financièrement ?
J’ai gardé la petite pension alimentaire que mes parents me donnaient avant que je ne fasse l’histoire. J’ai loué une maison au Béguinage de Louvain, j’y sous-louais des kots pour avoir un peu de revenus et j’ai aussi donné quelques petits cours.
L’histoire était donc votre vocation mais comment choisissez-vous votre période de spécialisation ?
J’ai choisi le Moyen-Âge par un accident tout à fait sympathique. Comme étudiants, nous devions faire des critiques de bouquins pour la revue d’histoire ecclésiastique de Louvain, une revue importante. Et un jour, je dois faire la recension d’un texte sur l’instruction des enfants au XIIIè siècle. Je me suis alors demandé s’il existait beaucoup de textes sur l’éducation de l’époque ? Et je me suis passionnée pour l’histoire de l’éducation au Moyen-Âge, avec du répondant immédiat. On m’a ainsi invitée à faire une brochure dans la collection des sources du Moyen-Âge sur les sources traitant de l’éducation. Je suis très consciente des hasards de la vie qui ont très bien tourné pour moi et je continue à les apprécier rétrospectivement. Des hasards qui ont suscité une ouverture. Je reste une passionnée du Moyen-Âge en général et des systèmes pédagogiques en particulier. J’avais fait une classification pour montrer la différence entre les conseils de l’éducation au XIIIè siècle qui devaient permettre d’opérer la distinction sociale tandis que plus tard, comme le disait Philippe Ariès, la cléricalisation de l’enseignement devait aboutir à la non-spécificité sociale des élèves. Seulement, la plupart des écrits étaient destinés aux oblats (2), ils n’étaient pas pour la société civile. Mais, par mes recherches, j’ai trouvé quand même des traités de grands bourgeois et de petits bourgeois, de petites et de grandes aristocraties, qui avaient des conceptions pédagogiques très différentes de ces traités cléricaux. Ces sujets sont depuis ancrés en moi définitivement comme des passions. J’ai donc enfin pu m’investir en histoire, en histoire du Moyen-âge avec un plaisir et une autonomie retrouvés, une joie énorme ! Dès la fin de mes études, mon directeur de thèse, le grand médiéviste Léopold Genicot, me propose d’être son assistante.
Pourquoi n’avez-vous pas poursuivi une carrière académique alors ?
A cause d’un conflit à la base tout à fait banal. Les assistants étaient excédés par l’inégalité de traitement entre eux. Quand tu étais bon et apprécié, tu te retrouvais avec tout le boulot à faire et du coup tu traînais pour ta thèse de doctorat que tu n’arrivais pas à faire en temps voulu. Si ton directeur de thèse aimait ta façon de travailler, il te demandait de participer à ses propres travaux et tu avais encore plus de surcharge de travail.
Une enquête a montré que, parmi les assistants les plus surchargés, les deux premiers étaient en histoire. La revendication des assistants, c’était d’avoir un statut définitif de chercheur, parce que le statut d’assistant, c’était trois fois deux ans et si tu n’avais pas fini ta thèse dans ce laps de temps, c’était au revoir et merci. Et donc on considérait qu’on avait déjà fait les preuves de nos capacités et on demandait un statut définitif. Moi j’étais déléguée du personnel scientifique et donc j’ai été voir Genicot pour lui faire état de cette revendication. Ma situation personnelle n’était pas en jeu puisqu’il m’avait déjà dit quels cours il me donnerait quand j’aurais fini ma thèse, tout s’annonçait bien pour moi. Je lui explique donc poliment nos demandes, en lui disant bien que ce n’était pas contre lui personnellement, que cela n’avait rien à voir avec mon cas individuel, que j’étais très contente d’être son assistante mais que c’était pour obtenir collectivement ce statut. Et lui, avec une violence inouïe, il me répond : « Si vous faites ça, je vous fous à la porte ! ».
Et vous restez sur vos positions ?
Oui, bien sûr. Et Genicot a mis aussitôt sa menace à exécution. C’était très dur pour moi, c’est une blessure fondamentale. Le recteur me dit que je peux passer ma thèse tout de même. Mais, sans connaître mon sujet, avant de m’avoir lu, un potentiel membre du jury me dit déjà : « avec un tel conflit avec Genicot, tu te rends bien compte qu’il n’y a personne qui acceptera de te donner plus qu’une satisfaction ». Là je me suis dit que ce n’était pas acceptable et j’ai quitté l’UCL. Nous sommes en 1972. C’était une blessure effrayante. Je me retrouve au chômage. Je suis très aidée par un groupe d’assistants qui est scandalisé par ce qui s’est passé et organise un petit groupe militant. Il ne faut pas oublier que nous sommes en plein dans la vague qui réclame la démocratisation de l’Université catholique, que les profs ne soient plus nommés par les évêques, qu’il y ait plus de respect pour les assistants etc. Avec ce petit groupe, nous continuons à travailler sur la démocratisation de l’enseignement, nous sommes invités à donner des cours d’éducation permanente aux travailleurs grecs de la CSC.
Pourquoi les travailleurs grecs ? Parce que dans ce petit groupe, il y avait un doctorant en sciences hellénistiques. Il connaissait le grec ancien mais aussi le grec moderne. Il le parlait très couramment donc c’était très facile de travailler avec les travailleurs grecs. Suite à ces contacts avec la CSC, je donne aussi des cours d’histoire sociale à l’ISCO, l’Institut supérieur de culture ouvrière. A chaque fois j’acquiers des choses importantes, par exemple qu’on reçoit autant de la personne enseignée que ce qu’on lui donne. Avec les travailleurs grecs, je découvre que ce qu’ils ont autrefois appris de l’histoire de leur pays (la «démocratie athénienne», etc.) ne concernait pas l’histoire des classes populaires. Ils avaient fui la dictature des colonels, c’étaient en général des ouvriers de condition modeste, en Grèce comme ici. A l’ISCO, j’ai aussi appris énormément puisqu’on devait coter les étudiants plus sur les progrès qu’ils avaient réalisés au cours de leurs années d’étude que sur des résultats absolus. C’est important mais très difficile.
Ces cours d’histoire sociale, c’est vous qui les avez construits ?
Oui c’est la CSC qui m’a demandé de donner ces cours d’histoire sociale et je les ai construits.
Comment passe-t-on de l’instruction au Moyen-Âge à l’histoire sociale ?
Ce n’est pas étonnant puisqu’en fin de compte, la Révolution française apparaît comme la suppression des structures sociales du Moyen-Âge. Quand j’aborde l’histoire du mouvement mutuelliste par exemple, je trouve dans les mutualités d’avant la Révolution française une continuité et je peux présenter une interprétation très alternative de la Révolution française puisque, évidemment, la suppression des corporations, c’est aussi la suppression des organisations ouvrières de base. Les grands spécialistes de l’histoire des mutualités se focalisent sur la période contemporaine alors que l’on peut trouver des sociétés de secours mutuel dès l’époque romaine ! C’est aussi une occultation de faire des coupures comme s’il n’y avait pas de continuité pour le mouvement mutualiste. Et quand on dit que la Sécurité sociale date de 1945, évidemment ça me fait bondir ! Donc dans mes cours à l’ISCO, j’ai voulu faire de l’histoire sociale, l’histoire du mouvement social, l’histoire de comment les travailleurs les plus modestes essaient de se libérer de l’oppression, de l’exploitation, etc.
Vous rencontrez beaucoup de monde sans doute ?
Bien sûr, je rencontre évidemment beaucoup de membres du monde ouvrier chrétien. Après la première journée des femmes du 11 novembre 1972 à Bruxelles, Miette Pirard (3), qui était codirectrice du service féminin de la CSC avec Sara Masselang, son homologue flamande, invite Françoise Collin (4) et moi dans ses formations de militantes pour que nous expliquions le combat féministe et entrions en dialogue avec elles. Dans le même temps, je rencontre aussi Émile Creutz qui avait été un promoteur des crédits d’heures au sein du MOC (Mouvement ouvrier chrétien). et qui voulait réaliser un bilan de l’utilisation de ces crédits d’heures pour consolider le système. Et donc nouvel hasard heureux, il me demande si je ne veux pas, via un contrat à durée déterminée de trois mois, faire les statistiques de ces crédits d’heure. Il faut dire que le département des crédits d’heure au ministère était tellement surchargé de travail que plus personne ne pouvait leur parler, le ministre ne pouvait plus leur imposer quoi que ce soit et dès lors le ministre a accédé à l’idée que quelqu’un d’extérieur vienne faire un bilan. Donc j’ai fait ce calcul pour Émile Creutz. Dans la foulée, on installait au sein du ministère la commission du travail des femmes (décision prise en 1974, installation en 75). Il s’agit d’une commission paritaire comprenant donc des représentants des travailleurs et des patrons, ainsi que de l’État. Miette Pirard et Sara Masselang y représentaient la CSC et Miette me dit « Hedwige, je vais demander au ministre qu’il t’adjoigne au secrétariat de la commission du travail des femmes parce que comme cela, on peut discuter ensemble, je sais ce qu’ils vont préparer, etc. » Donc là, pendant que je suis en train de faire mes stats sur les crédits d’heure, je sais que je suis nommée à temps plein pendant un certain temps au secrétariat de la commission du travail des femmes, ce qui me passionne. J’y suis restée deux ans et demi.
La thèse, c’est définitivement fini alors ?
Non non, pendant cette même période je cherche une solution pour passer ma thèse de doctorat. Je dois trouver un directeur de thèse, soit en histoire générale mais qui dans ce cas doit être de renommée supérieure à Genicot pour qu’on ne dise pas que c’est un succédané, soit un historien de l’éducation. Il y a un historien de l’éducation qui me convient en Angleterre mais qui ne travaille qu’en anglais, or je ne connais pas un mot d’anglais. Il y en a un aussi à Paris mais que je n’ai pas eu envie de consulter parce que je le trouvais trop classique. Donc je m’adresse à Jacques Le Goff, célèbre médiéviste français. A ce moment-là, j’ai mon plan de thèse, je suis déjà très avancée. Je n’arrive pas les mains vides. Il accepte et il dit : « Très bien, je peux le faire, simplement il faut d’abord que vous assistiez pendant deux ans au séminaire des doctorants chez moi et ensuite il faudra la passer à une université avec un professeur qui peut être affecté parce que moi je n’ai pas encore le droit de faire passer les thèses. » Il était directeur d’études à l’École pratique des hautes études, donc pas une université et cela devait être une université. Donc je fais ce séminaire pendant deux ans, très stimulant pour moi, je vois tous ces Français, ils ont tout lu , on est dans Foucault et toutes sortes de trucs que je ne connais pas du tout. J’ai mis un certain temps à me rendre compte qu’ils étaient quand même assez bluffeurs mais enfin ils avaient en théorie tout lu. Le problème de ce séminaire est qu’il se déroulait de 18 à 20h. Or, à cette époque, il n’y avait pas moyen le soir de rentrer de Paris à Bruxelles en train. Donc j’ai logé dans un petit hôtel le mardi soir, pendant près de deux ans et, comme j’avais déjà un enfant, Frédéric, c’est mon mari qui s’occupait de lui à ce moment. J’ai éprouvé concrètement qu’il y a une forme de liberté qui repose sur le conjoint et qui s’exerce bien sûr plus souvent dans l’autre sens.

Et donc cette fois ça aboutit ?
Oui je passe brillamment ma thèse à Paris X avec dans le jury le spécialiste de l’histoire de l’éducation avec qui finalement ça se passe très bien. Cette réussite me met beaucoup de baume au cœur d’autant que Le Goff me propose une place provisoire à l’université d’Orléans, en me disant que je pourrais monter à Paris après. En outre, le fameux prof d’histoire de l’éducation me propose de faire un chapitre sur l’histoire des sources pédagogiques dans son encyclopédie de l’histoire de l’éducation et Le Goff me propose de publier un résumé de ma thèse dans la revue des Annales (il est depuis 1969 l’un des membres du directoire de cette prestigieuse revue d’histoire). Désormais, pour moi, la plaie est cicatrisée. J’ai déjà, comme prévu, l’engagement à la commission du travail des femmes. J’ai toutes les raisons, familiales et professionnelles, pour décliner les propositions françaises.
Quel est le titre de votre thèse ?
« Principes pédagogiques et classes sociales au XIIIème siècle »
Vous y abordez déjà la question des femmes ?
Non, pas du tout et je ne l’ai pas vue. Certes je m’étais rendu compte que je n’avais trouvé qu’un seul traité destiné aux femmes. Un grand noble allemand avait fait un traité pour son fils. Et puis il y a aussi un autre traité pour sa fille dont on ne se sait pas si c’est une copie ou si c’est quelqu’un d’autre qui l’a fait. Par contre, il y a un très célèbre traité, mais qui n’entrait pas dans ma période, c’est le manuel de Dhuoda. Cette grande reine wisigoth a fait un très bon traité au neuvième siècle pour son fils mais elle est toute seule dans son genre et elle ne rentrait pas dans ma période. Ma problématique était : « Comment éduque-t-on les enfants des divers milieux sociaux ? Que souhaitent leurs parents pour eux ?» Je renonçais à tous ces traités commandés ou offerts aux «princes» mais qui, en fait, concernaient plus les petits oblats élevés dans les abbayes. Donc, dans ma thèse, je n’ai pas vu de ségrégation genrée, cela ne m’est pas apparu comme une problématique majeure, je travaillais sur les classes sociales, j’étais marxisante à ce moment-là et je voulais montrer que l’éducation avait pour fonction de déterminer la classe sociale de l’enfant.
Donc, après cet épisode de la thèse à Paris, vous revenez travailler en Belgique pour Miette Pirard !
Oui, le secrétariat de la commission du travail des femmes, cela nécessite de tenir compte de ce que pensait le syndicat, de ce que pensaient les femmes du syndicat et de ce que pensait le patronat. C’était une formidable initiation à la concertation sociale. Par exemple, sur les temps partiels, les patrons sont demandeurs, les hommes plus ou moins aussi, le syndicat moitié moitié et le service féminin pas du tout. Forcément, on apprend beaucoup. Au plan contractuel, il faut savoir que j’étais là comme chômeuse mise au travail. A un moment, on me dit : « En fait tu pourrais rester à la commission du travail des femmes mais tu devrais passer le concours de recrutement auprès du Secrétariat général au recrutement du personnel de l’État ». Ça me paraissait insurmontable. J’avais déjà fait de mauvaises candidatures à Liège en sciences politiques et sociales, notamment en ayant trébuché sur le droit administratif. J’avais déjà fait tout ce travail pour ma thèse, ce concours c’en était trop pour moi.
Un nouvel « hasard heureux » survient alors ?
Eh bien oui ! A l’ISCO, où j’avais rencontré Émile Creutz, je rencontre ensuite Édouard Descampe qui travaillait au service d’études des Mutualités chrétiennes et allait devenir peu après l’adjoint du secrétaire général Jean Hallet, auquel il succédera quand ce dernier partira à la pension. Et Édouard Descampe me dit : « Mais, au fond, est-ce que tu ne veux pas entrer à la mutuelle pour reprendre le journal En marche ». Je réponds favorablement mais cela prend un certain temps parce que Hallet est apparemment assez opposé à engager quelqu’un qui commence à avoir une réputation de féministe. Mais pour finir ça se concrétise, j’entre à la mutuelle et j’y ai travaillé pendant vingt-et-un ans, jusqu’à la retraite, comme responsable du journal En marche.
Et la militance féministe n’a pas posé de souci finalement ?
Il y a eu des hauts et des bas, mais ils ont quand même été assez courageux parce que je n’étais pas de tout repos. J’avais mes activités et écrits extérieurs et souvent ils craignaient que mes idées personnelles et ma fonction soient confondues. Il m’est arrivé pour des questions trop personnelles ou trop sensibles d’utiliser un pseudonyme comme Isabelle Dufour. Mais par ailleurs, j’étais aussi très engagée dans la défense du mouvement mutuelliste, ce que Jean Hallet a reconnu.
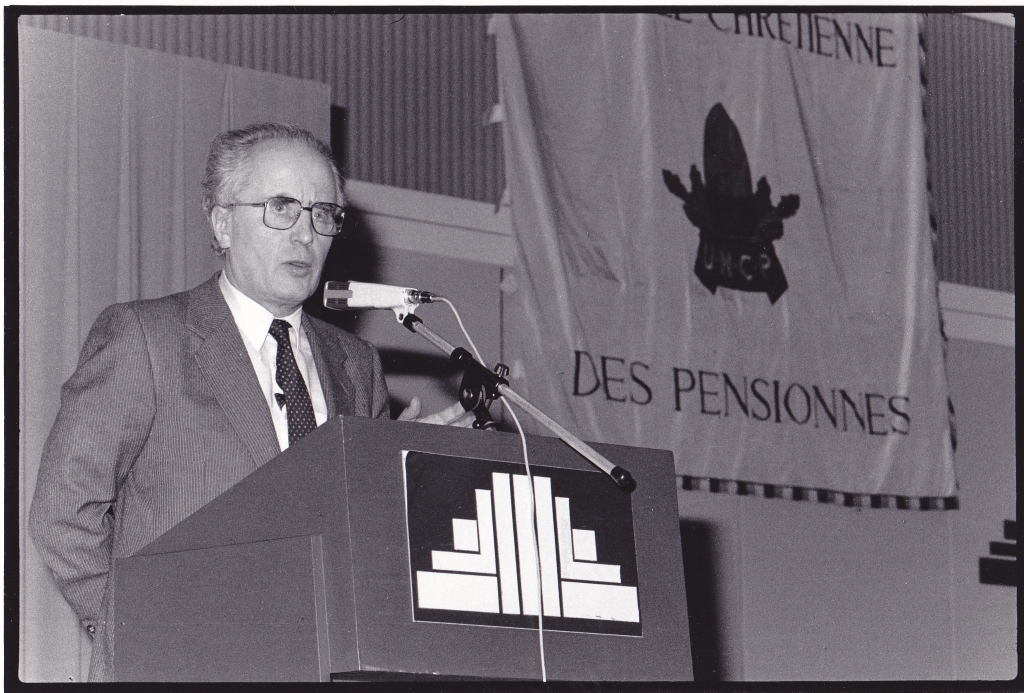
Cette inscription dans le pilier chrétien, c’est un hasard ? C’est lié à des contacts de l’université ? C’est familial ?
Mes parents n’étaient pas dans le mouvement social chrétien . Ils étaient très pratiquants, assez traditionalistes, royalistes, légitimistes. Quand j’étais à Louvain, surtout quand j’étais assistante, comme je l’ai dit précédemment, on était quand même déjà dans les manifestations, dans le mouvement de démocratisation de l’Université. Personnellement, je suis clairement de tradition chrétienne, je suis longtemps restée pratiquante et adhérente et je me reconnais comme de tradition, j’allais dire presque de civilisation, chrétienne. Je n’ai guère connu mon grand-père, Prosper Poullet qui a été député catholique de Louvain toute sa vie et proche du mouvement ouvrier chrétien (mutualité, syndicat, coopératives…) J’ai découvert cela seulement quand j’ai moi-même travaillé sur ces questions. Mes parents évoquaient son rôle dans le mouvement flamand, comme ministre et comme professeur d’Université…
Il a aussi été plusieurs fois ministre et même Premier ministre ! (5)
Oui, effectivement mais j’en avais une vision partielle, je n’étais pas vraiment consciente de cet « héritage ». Je ne savais pas non plus que ma grand-tante, Mamieke Belpaire avait eu l’intention de créer un pilier social chrétien féminin ! Qu’on ne vienne pas me dire : « Tu ne fais qu’imiter ton grand-père ou ta grand-tante !» Pour des choses que je découvre en cours d’action ou de recherches. Ainsi, au cours de mes années de mutuelle, un jour comme j’étais engagée dans une commission d’économie sociale, présidée par un secrétaire de la fédération de Louvain très sceptique sur le thème de l’économie sociale, ce président, tout à coup m’interpelle : « Poullet, ça a un rapport avec Prosper Poullet ? ». Je réponds : « Oui c’était mon grand-père » . Alors, il s’est ravisé et a dirigé le groupe avec plus de zèle.
La commission du travail des femmes, finalement, cela aurait pu être un emploi comme un autre. Qu’est-ce qui fait que vous devenez une militante féministe ?
Au point de départ, mon « entrée en féminisme » est aussi accidentelle que l’histoire du traité de l’éducation. Mon frère Édouard, qui s’occupait de La Relève, un périodique de la démocratie chrétienne, me demande si je connais Françoise Collin ? Je lui réponds que non. Il me dit : « Elle est secrétaire de rédaction ici, et je sais qu’elle constitue un groupe de femmes. Est-ce que cela t’intéresse ? » Je dis oui. Françoise Collin me téléphone et elle m’indique que la prochaine réunion du groupe a lieu telle date et tel jour. J’y vais, et depuis lors, je n’ai plus quitté le féminisme ni Françoise Collin . Donc ce premier groupe est un groupe de prise de conscience, c’est-à-dire qu’on y met sur la table tout ce que l’on éprouve qui ne va pas dans la société patriarcale ou dans les relations avec les hommes, personnellement ou collectivement. Nous y mettons le doigt sur les discriminations subies. Par exemple, Françoise Collin explique qu’elle était docteure en philosophie en même temps que son mari et que quand elle a voulu présenter sa candidature pour être nommée prof, l’université lui a dit : « On ne peut pas nommer prof à la fois le mari et la femme ». Pour Françoise, c’était la blessure féministe initiale. Pour ma part, je savais que mon conflit avec Genicot n’avait pas de dimension genrée même si certains ont essayé de lui donner une origine sexuelle…. Quand le délégué de la CNE est allé voir le recteur pour demander pourquoi on me mettait à la porte, il aurait répondu : « Oui mais vous savez il vaut mieux pour son mari que cette histoire cesse ». Mais pour moi, ça n’avait rien à voir.
Ce groupe avec Françoise était super intéressant et très drôle. On riait tout le temps, on démystifiait des hommes qu’on croyait importants, supérieurs, c’était très joyeux. Et puis en 1972, il y a Le petit livre rouge des femmes, publié par les Editions Vie Ouvrière, qui part comme des petits pains et bien sûr la première journée des femmes. Elle est organisée par des personnes qui ne sont pas de ce groupe comme Miet Smet et Marie Denis. Le succès est incroyable, dix mille femmes qui nous stupéfient alors qu’on croyait qu’on n’était qu’un petit groupe dans un coin. Nous sommes enthousiasmées par les discours de Simone de Beauvoir et Germaine Greer. C’est un démarrage en trombe. Nous sortons de là, le petit groupe de Françoise Collin , en nous disant que nous devons faire une publication pour la prochaine journée des femmes. Nous adoptons le nom GRIF (groupe de recherche et d’information féministe) et on décide de faire une publication pour 1973 et cette publication c’est le premier numéro du GRIF : « Le féminisme pour quoi faire ?» qui est entièrement épuisé lors de la deuxième journée des femmes. On voit donc qu’il y a une grosse attente, une demande importante.

Les participantes à ce groupe, c’est une élite intellectuelle ou c’est assez mixte socialement?
C’est plutôt intellectuel oui. Les noms des participantes se trouvent dans tous Les Cahiers du GRIF. Il y a là Jeanne Vercheval, Geneviève Simon, Jacqueline Aubenas, Marie Denis, Suzanne Van Rokeghem, Françoise et moi bien sûr, etc. Les Cahiers du GRIF sont vite subsidiés en éducation permanente, ce qui va nous amener à avoir des locaux, dont une bibliothèque. Nous avons besoin de personnel aussi, nous obtenons des postes ACS (agent contractuel subventionné), en devant engager des femmes de niveau ouvrier. Nous avons la chance de recruter quelques femmes qui sont malencontreusement ouvrières « par accident », soit parce qu’elles ont quitté un mari, soit parce qu’elles sont étrangères ou ont dû interrompre leurs études, etc. On a donc démarré avec une « mixité sociale » un peu artificielle. Pendant cinq ans, on a donc fait ces cahiers, nous avons terminé par le numéro double 23/24 « Où en sont les féministes ? ». Ces cahiers étaient largement basés sur le vécu, comme le groupe de prise de conscience, avec une insatisfaction assez croissante par rapport à cette idée du vécu, une volonté de comprendre, de savoir le pourquoi et le comment. On avait aussi le souci de tenir compte de l’actualité. Chacune d’entre nous assumait un numéro d’un cahier. Moi j’ai réalisé évidemment un numéro sur la Sécurité sociale avec quelqu’un de la CNE, puis « Les femmes contre la crise » avec Jeanne Vercheval je crois. J’ai aussi travaillé sur le rexisme, avec Jacqueline Aubenas. Il y avait une bonne collaboration entre nous, tout le monde lisait tout ce qu’on faisait. A la longue cependant, il y a eu une certaine lassitude et certaines voulaient avoir une visibilité plus grande dans le public et donc lancer un magazine. C’est ce qu’elles feront en créant le magazine Voyelles qui paraîtra pendant trois ans (1979-1982).
Et donc une partie de l’équipe rejoint Voyelles : Marie Denis, Jacqueline Aubenas, Suzanne Van Rockeghem… Malheureusement, et comme je le craignais, malgré toutes ces femmes qui sont de bonnes plumes, le magazine ne se vend pas assez pour être viable. J’ai toujours été opposée à rémunérer d’emblée les contributrices, on sait très bien qu’avec le seul lectorat de la partie francophone du pays, on ne peut pas payer les autrices. Et pourtant, avec Les Cahiers du GRIF, nous avions atteint le plus gros tirage francophone possible, qui dépassait la Revue nouvelle qui à mon avis était de 7.000 abonnés. On avait, à ce moment-là, capté la France et le Canada aussi. L’autre groupe va s’orienter vers la recherche, la compréhension des questions abordées. Il s’appellera Grif-Université des Femmes, les deux noms ensemble. Nous commençons par organiser un colloque très important intitulé « Enfants des femmes ou enfants de l’homme ». L’idée était de déconstruire le précepte qui veut que la maternité définirait les femmes et montrer qu’en fait nous étions obligées de faire des enfants pour les hommes. C’est un colloque qui a très très bien marché mais qui a malheureusement marqué le début d’un conflit entre Françoise Collin et moi. Conflit qui a abouti à ce que l’on n’a pas publié les actes du colloque qui sont toujours dans les archives de l’Université des Femmes.
Quelle est la nature de ce conflit ?
Le dédoublement Grif-Université des Femmes va être tout à fait conflictuel. L’aspect visible est financier et l’aspect invisible est que d’une part, Françoise Collin était branchée sur l’aspect culturel et produisait des écrits très intéressants du point de vue culturel mais que d’autre part, elle avait envie d’être connue à l’international, dans la foulée du colloque « Enfants des femmes ou enfants de l’homme ». Moi, au contraire, je voulais que nous ayons une production féministe qui soit utile socialement aux Belges, donc je voulais viser les organisations sociales, les organisations syndicales. Je voulais mettre en évidence les discriminations au niveau belge. La question d’argent n’a pas arrangé les choses. Ce conflit a été tranché par un accord de séparation où d’un côté, Françoise Collin pouvait partir avec une partie de l’équipe et appeler son association « Ateliers du GRIF » et de l’autre côté, je pouvais partir avec mes « adeptes » pour créer une association qui s’appellerait « Université des Femmes ». Cela a été un gros choc.
Dans notre numéro de décembre, nous explorerons la suite du parcours d’Hedwige Peemans – Poullet en évoquant bien sûr l’Université des Femmes, le Comité de liaison des femmes et le combat pour l’individualisation des droits suite à l’introduction du statut cohabitant en 1981…
Portrait de Jacques Bude : précisions
Nous avons récemment publié un portrait de Jacques Bude, professeur émérite en psychologie sociale de l’ULB, sous le titre général « Combattre la déshumanisation, sous toutes ses formes ». La première partie, intitulée « Enfance et jeunesse, dans le moule du génocide » a paru aux pages 64 à 72 de notre numéro 101 (décembre 2019), et la seconde « Condamner toute dévalorisation de l’autre et de soi-même, une réaction automatique », aux pages 38 à 53 de notre numéro 102 (juin 2020). (1) Jacques Bude a tenu à apporter quelques précisions suite à la parution de cette seconde partie.
Suite à des remarques qui m’ont été faites par des amis, j’aimerais faire une mise au point. Matéo Alaluf (2) qui a eu la chance de disposer du bureau des Étudiants socialistes à la Maison du Peuple, m’a appris que ce que je dis des responsables syndicaux et de leurs chauffeurs est faux. Ce qui m’a fait plaisir. Mon erreur est d’autant plus regrettable qu’elle rejoint une campagne de dénigrement du monde syndical qui, selon Matéo, est largement répandue. À l’époque, le Parti socialiste participait au gouvernement. Il s’agissait donc probablement de ministres, secrétaires d’État et autres hauts fonctionnaires. De plus, il paraît invraisemblable à Matéo que les chauffeurs portaient un uniforme. Mon indignation m’a sans doute joué des tours.
Il y a par ailleurs un passage qui induit en erreur sur la quantité de territoires dont disposent encore les Palestiniens. « L’État d’Israël a confisqué – officiellement ou de fait – au moins 70% du territoire palestinien. » Il s’agit en fait du territoire de la Cisjordanie. En ce qui concerne l’actuel « Grand Israël », Israël et les territoires occupés, les Palestiniens qui constituent à peu près la moitié de la population, ne contrôlent que 15% du territoire, constitué en majeure partie de sols arides et d’agglomérations surpeuplées, systématiquement privées de ressources, notamment de terres cultivables. De plus, la confiscation du peu de terres qui restent aux Palestiniens, se poursuit et s’accélère.
On m’a également signalé que ma mise en garde contre l’utilisation de la notion d’antisionisme était plutôt confuse. J’ai réécrit un paragraphe en essayant de clarifier les choses :
« Ne fut-ce que parler d’antisionisme, c’est s’inscrire dans la mythologie sioniste et se laisser manipuler par la propagande israélienne. Qu’est-ce que l’antisionisme – l’opposition au mouvement qui œuvre à la création d’un État israélien – pourrait bien signifier aujourd’hui ? L’opposition à l’aspiration à créer un État qui existe depuis plus de 70 ans et dont l’existence n’a jamais été menacée ? L’opposition à ce que des gens qui le désirent puissent s’installer en Israël et devenir Israéliens ? Ça n’a aucun sens. Mais évoquer l’antisionisme – la volonté de détruire le seul refuge contre l’antisémitisme génocidaire qui, selon la mythologie sioniste, est et a toujours été endémique dans le monde entier – permet à la propagande israélienne de présenter toute dénonciation des crimes israéliens, non pas comme l’expression d’une révulsion face à des crimes bien réels mais comme de haineux mensonges proférés par des antisémites génocidaires qui cherchent à « délégitimer » le démocratique État juif afin de justifier sa destruction. Force est de constater l’efficacité de ce mode d’occultation des politiques criminelles de l’État d’Israël. À nous de ne pas y contribuer en ergotant sur l’antisionisme au lieu de nous en tenir à identifier les crimes et à les dénoncer conformément aux obligations qui découlent des définitions du crime contre l’humanité par le statut du tribunal de Nuremberg et du crime de guerre par la quatrième Convention de Genève. »
(1) Deux numéros disponibles en pdf sur le site www.ensemble.be
(2) Matéo Alaluf, sociologue du travail, était collègue et est ami de Jacques Bude.
- Par Propos recueillis par Valérie Lootvoet (UF et CSCE) et Yves Martens (CSCE)
(1) Lire Hedwige Peemans – Poullet, « Faire table rase : l’obsession simplificatrice », Ensemble n° 89, décembre 2015 et Hedwige Peemans-Poullet, « Revenu de base ECOLO : universel sans les femmes ? », Ensemble n°97, septembre 2018.
(2) Personne qui s’est agrégée à une communauté religieuse, mais sans prononcer les vœux.
(3) Sur Miette Pirard, voir https://maitron.fr/spip.php?article218898, notice PIRARD Marie-Henriette, dite Miette, épouse BAPAUME. par Hedwige Peemans-Poullet, version mise en ligne le 10 septembre 2019, dernière modification le 24 août 2020.
et Coenen M-T., « Marie-Henriette Pirard, dite Miette : un engagement intégral », Analyse en ligne du CARHOP, septembre 2019, mis en ligne le 30 septembre 2019
(4) Sur Françoise Collin, lire Kaufer Irène, « Parcours féministe (entretiens avec Françoise Collin) », Labor, 2005, réédition iXe 2014.
(5) Prosper Poullet (1868 – 1937) a été membre de la Chambre des représentants de 1908 jusqu’à sa mort. Il en fut même le président lors de la session 1918-1919. De 1911 jusqu’à peu de temps avant sa mort, il occupa plusieurs fois des postes de ministre, à la tête de différents départements. Sa carrière politique fut couronnée par la fonction de Premier ministre qu’il occupa en 1925-1926. Il reçut le titre de vicomte en 1925 et fut fait ministre d’État en 1926.
Nos remerciements chaleureux vont à Marcelle Diop (Université des Femmes) qui a assuré la retranscription brute de cette interview.