Pour la solidarité, Contre L'exclusion
exclusion du chômage
Sorties du chômage : « C’est quand qu’on va où ? »
Que faire avant la fin de droit pour essayer de l’éviter ? Tentatives de réponses…
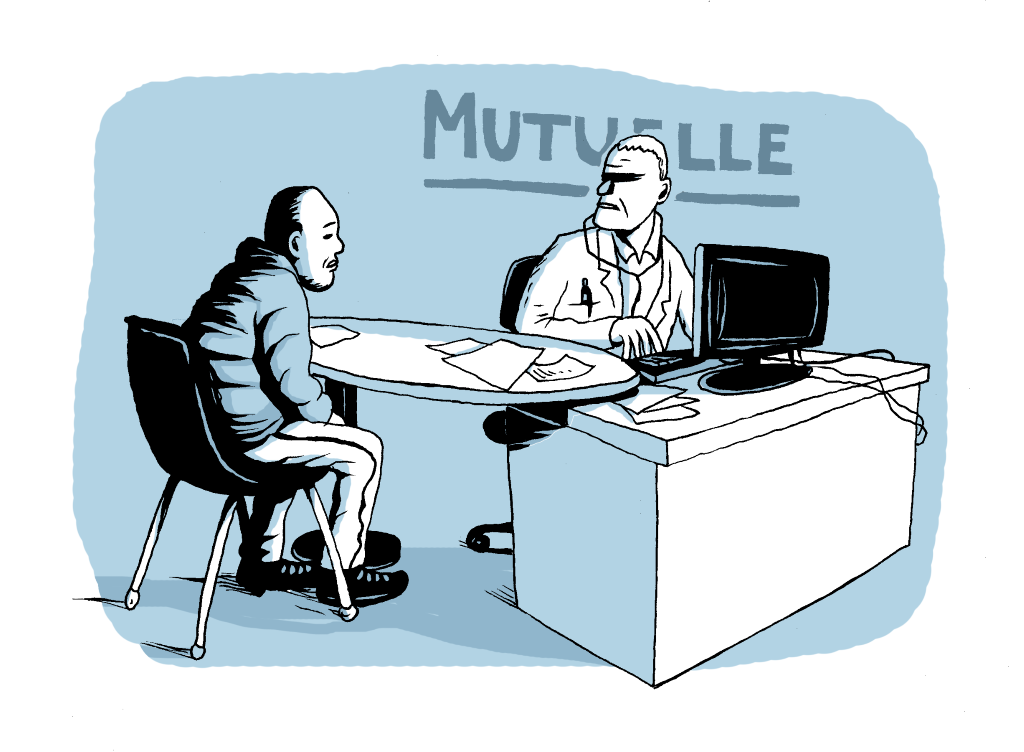
La limitation dans le temps des allocations pose de nombreuses questions, dont deux urgentes pour les personnes au chômage actuellement. Primo, que puis-je faire avant l’exclusion pour tenter de l’éviter ? Secundo, que va-t-il m’arriver si je n’ai pas trouvé de solution avant ma fin de droit ? (Lire ici) Le credo répété du gouvernement est que la menace de la fin de droit va provoquer un électrochoc et pousser les futurs exclus à chercher du travail. Vont-ils en trouver pour autant ? A fortiori, vont-ils trouver le Graal d’un emploi à temps plein, seul à même d’améliorer significativement leur situation actuelle ? D’office pas tous. Le ministre fédéral de l’Emploi, David Clarinval (MR) a lui-même déclaré au printemps : « Il y a 160.000 emplois vacants en Belgique aujourd’hui et il y a plus de 200.000 chômeurs qui pourraient prendre ces emplois mais qui ne le font pas ». (1) Et, en effet, Statbel parle d’emplois vacants dans cet ordre de grandeur.
Mais l’office belge de statistique donne la définition suivante : « Un « poste vacant » est un emploi rémunéré nouvellement créé, non pourvu, ou qui deviendra vacant sous peu, pour le pourvoi duquel l’employeur entreprend activement de chercher, en dehors de l’entreprise concernée, un candidat apte et est prêt à entreprendre des démarches supplémentaires ; qu’il a l’intention de pourvoir immédiatement ou dans un délai déterminé. » (2) Emplois vacants ne veut donc pas dire emplois en pénurie ni postes tous disponibles pour les futurs exclus. Ce n’est pas parce qu’un poste d’infirmière ou de comptable attend d’être pourvu à Bruges que l’ex-caissière du Cora de 50 ans exclue du chômage à Farciennes pourra occuper cet emploi. Un poste reste vacant souvent parce que l’employeur ne trouve pas « chaussure à son pied », même s’il a eu des candidats. L’on sait que beaucoup d’employeurs rechignent à engager des chômeurs, surtout de longue durée. Et, quand bien même ces 160.000 postes étaient octroyés à des chômeurs, il y en a 230.944 chômeurs menacés d’exclusion, soit bien plus que le nombre d’emplois vacants. La sortie vers un emploi temps plein ne sera malheureusement possible que pour un nombre limité de personnes, a fortiori pour les chômeurs de longue durée. Quelles sont les autres options possibles ?
Soucis de santé ?
La première chose à vérifier pour les chômeuses et les chômeurs menacés, c’est s’ils sont médicalement en état de travailler. La question peut sembler étonnante puisqu’un chômeur est censé être disponible sur le marché de l’emploi. Normalement, lorsqu’un chômeur est malade et sous certificat médical établissant une incapacité de travail, il met des « M » sur sa carte de contrôle et doit transmettre le certificat dans les quarante-huit heures à la mutuelle. Étant donné l’exigence de disponibilité, il est logique que le chômeur soit indemnisé par la mutuelle lorsqu’il est malade et non par l’ONEm. Cependant, par analogie avec les travailleurs qui bénéficient d’un salaire garanti pendant les trente premiers jours d’incapacité (avec des modalités un peu différentes pour les employés et les ouvriers), on pourrait revendiquer que les chômeurs ne doivent pas si rapidement « tomber » à la mutuelle. D’autant que, lorsque la période d’incapacité atteint au moins quatre semaines, le sans-emploi doit introduire une nouvelle demande d’allocations auprès de son organisme de paiement. Cette demande doit être introduite au moyen d’un formulaire C 6 délivré et complété par la mutuelle.
Le chômeur doit également compléter lui-même une partie de ce formulaire. Pourquoi alors ne pas exiger de n’enclencher ces lourdes démarches que lorsque la maladie dure plus d’un mois ? Les transferts de caisse entre mutuelle et organisme de paiement des allocations de chômage (syndicat ou CAPAC) posent en effet des difficultés (principalement des ruptures de paiement) qui font que le chômeur qui pense que son incapacité sera courte va éviter d’effectuer ces démarches. Il arrive aussi souvent que le sans-emploi qui vit des problèmes de santé « préfère » rester au chômage que de passer à la mutuelle, cela afin de pouvoir plus facilement répondre aux opportunités d’emploi (compatibles avec son état de santé) qui se présentent. Cette situation est plus fréquente qu’on ne le croit, nous l’avons rencontrée souvent chez les chômeurs que nous accompagnons et qui travaillent régulièrement, dans la mesure et l’intensité que leur état de santé permet. « Passer » à charge de la mutuelle éloigne en effet les chômeurs de l’emploi, ce qui est un fameux paradoxe quand le gouvernement prétend vouloir les en rapprocher ! Une partie des chômeurs de longue durée sont donc en fait des personnes malades de longue durée et susceptibles d’être reconnues et indemnisées en tant que telles.

Faire le pas
En cas d’exclusion imminente ou proche, il ne faut plus tergiverser. Il faut aller voir son médecin si on a des soucis de santé (nous ne conseillons donc pas ici de jouer « Le malade imaginaire » mais de faire constater un état réel) et lui demander s’il estime que l’état de santé justifie une incapacité de travail d’une certaine durée. Il ne doit évidemment pas s’agir d’une grosse grippe, d’une affection temporaire, mais d’un état de santé ne permettant pas de travailler pendant une période de plusieurs mois. Si c’est le cas, il faut donc envoyer le certificat médical dans les quarante-huit heures à la mutuelle et mettre des « M » sur sa carte de contrôle pour chaque jour de maladie jusqu’à la fin du mois. Si l’on est toujours malade le mois suivant, il ne faut plus conserver de carte de contrôle et il n’y a donc plus de démarches à effectuer envers son organisme de paiement des allocations de chômage (ni l’ONEm). En revanche, le chômeur malade devra évidemment se soumettre aux convocations de la mutuelle. Un médecin conseil de celle-ci sera chargé de confirmer ou non l’incapacité de travail. Le chômeur proche de la fin de droit n’est donc pas assuré d’être « sauvé » par le passage à la mutuelle. Mais, si l’incapacité de travail est reconnue, il sera indemnisé par la mutuelle même après qu’il aura atteint la date de son exclusion du chômage, et ce tant que durera la reconnaissance de cette incapacité.
Les montants sont fort proches de ceux du chômage et la logique de l’indemnisation est la même : un pourcentage du salaire perdu plafonné par jour, sur une base de six jours par semaine. La solution n’est cependant pas garantie et n’est donc possible que si l’on souffre vraiment de problèmes de santé pouvant donner lieu à une incapacité de travail qui va au-delà de la date de fin de droit. Il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’une solution définitive : l’incapacité cessera dès que le médecin conseil de la mutuelle jugera le chômeur à nouveau apte à travailler. Et l’on sait que le ministre de la Santé a déjà annoncé que les malades de longue durée seront poussés davantage encore à reprendre le travail. Cela présage sans doute une nouvelle chasse aux malades après la chasse aux chômeurs actuelle. Il n’empêche que le passage à la mutuelle est une piste à ne pas négliger. Il faut insister sur le fait que la possibilité de passer à charge de la mutuelle n’existe que tant que la personne n’est pas encore exclue du chômage. Il faut donc le faire de préférence avant la fin de droit, ou au plus tard trente jours après la fin de son droit. (3) Les indemnités d’incapacité de travail ont en effet seulement vocation à remplacer un revenu préalablement existant.
Prendre sa pension ?
Parmi les presque 50.000 chômeurs de plus de 55 ans concernés par la fin de droit, parce qu’ils ont moins de trente ans de passé professionnel (Lire l’article p. 22), près de la moitié (23.423) ont entre 60 et 64 ans et 448 ont même 65 ans. (4) Il semble donc logique de se demander si une prise de pension n’est pas possible. Le plus simple, même si cela ne l’est pas nécessairement pour tous étant donné que la fracture numérique est plus importante encore pour les plus précaires, le plus simple est de vérifier ce qu’indique mypension. Le site fournit à chacun la date de l’âge légal de sa pension qui, sans surprise, est celle du 1er jour du mois qui suit celui où la personne atteint 66 ans (ou 67 après 2030). Mais, généralement, est mentionnée également la date de pension la plus proche. Toutefois, pour les chômeurs âgés, il semble que cette seconde date n’apparaisse plus pour l’instant. Cela s’explique évidemment par les incertitudes concernant les nouvelles règles voulues par l’Arizona et qui ne sont pas encore (toutes) concrétisées. Il est recommandé aux chômeurs âgés de s’adresser, s’ils sont syndiqués, à leur centrale professionnelle (pas leur organisme de paiement) afin que celle-ci les aide à vérifier s’ils peuvent demander déjà leur pension. Il est bien sûr toujours possible également de s’adresser à l’Office des Pensions (la Tour des Pensions comme on dit couramment). Vérifier si, sur toute la carrière, l’ensemble des périodes de travail ou assimilées, par exemple le service militaire ou le service civil (objection de conscience), les congés de maternité, etc. est bien pris en compte par les administrations est une bonne pratique.
Études ? Emploi mi-temps ?
La prolongation durant le temps nécessaire pour terminer une formation ou des études de plein exercice menant à un métier en pénurie est prévue pour les personnes qui les ont entamées avant le 31 décembre 2025. (Lire l’article p. 20.) Cela concerne tant les personnes déjà inscrites dans un tel cycle formateur que celles qui s’inscriraient dans les semaines à venir, avant la date butoir de la Saint-Sylvestre. Ensuite, ce ne sera plus possible que pour les études d’infirmière et d’aide-soignante. Par ailleurs, le fait que, en cas de travail au moins à mi-temps, le complément chômage (allocation de garantie de revenus – AGR) soit maintenu pendant toute la durée du contrat de travail, pourrait inciter des futurs exclus à accepter un emploi mi-temps (minimum), là où ils ne l’auraient peut-être pas fait si leurs droits avaient été préservés. De façon plus générale, il nous semble clair que l’un des objectifs réels de la limitation dans le temps des allocations de chômage soit de forcer les (futurs) exclus à accepter des boulots à n’importe quel salaire et dans n’importe quelles conditions de travail. Signalons, pour être complet, que l’on peut garder son complément chômage si l’on est reconnu travailleur des arts. Pour les personnes ayant une pratique artistique professionnelle, l’allocation de travail des arts est accessible sous des conditions très précises. Il va de soi que cela ne pourrait concerner qu’un très faible nombre de personnes menacées par la fin de droit puisque l’activité artistique doit être dûment établie. Cela ne pourrait donc concerner que des personnes ayant effectivement ce type d’activités et qui ne l’avaient pas fait reconnaître jusqu’ici. (5)
Les prolongations possibles
La date d’exclusion mentionnée dans la lettre d’avertissement envoyée par l’ONEm est calculée en fonction de la situation du chômeur au 30 juin 2025 et des informations en possession de l’administration à la date mentionnée au début de la lettre, en dessous de l’encadré. Or, des événements qui auraient lieu après ce courrier et qui pourraient repousser la date d’exclusion ne sont évidemment pas connus de l’ONEm. C’est pourquoi, au verso de la lettre, les événements concernés sont spécifiés, dans un cadre suivi d’une seule phrase d’une explication assez lapidaire. Le chômeur qui est dans l’une de ces situations doit en avertir son organisme de paiement. Il s’agit des événements suivants, mentionnés dans le courrier de cette façon :
– le travail à temps plein ou le travail à temps partiel avec maintien des droits sans allocation de garantie de revenus d’une durée minimum de trois mois ;
– la formation professionnelle à temps plein d’une durée minimum de trois mois ininterrompus ;
– le travail sous statut d’indépendant ou de fonctionnaire durant au moins six mois ininterrompus ;
– la dispense comme aidant proche durant au moins six mois ininterrompus ;
– les interruptions de carrière ou crédit-temps (pas de durée minimum) ;
– les périodes couvertes par des indemnités de maternité (pas de durée minimum).
Exemple : Ouverture du droit au chômage en 2010. Date d’exclusion prévue : 1/3/2026. Formation professionnelle à temps plein du 1/7/25 au 31/12/25 (= 6 mois). Date de fin de droit repoussée au 31 août 2026. (6)
La lettre du syndicat
Les chômeurs affiliés à un syndicat reçoivent, en plus de la lettre d’avertissement de l’ONEm, un courrier complétant ces éléments avec par exemple des liens via QR code vers des ressources disponibles. FGTB et CSC proposent aussi, notamment, des séances d’information. Les quelques chômeurs qui nous ont contacté jusqu’ici oscillent entre le découragement et la crainte de devoir s’adresser au CPAS. Il est vrai qu’il vaut mieux être soutenu dans cette démarche… (Lire l’article p. 31.)
- Par Yves Martens (CSCE)
(1) Jeudi en Prime, RTBF, 17 avril 2025.
(2) « Baisse du nombre d’emplois salariés vacants », Statbel, 11 septembre 2025.
(3) Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 : Article 131. Les indemnités incapacité de travail ne sont dues aux titulaires qu’à la condition qu’il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de leur incapacité de travail et le dernier jour d’une période pendant laquelle ils avaient la qualité de titulaire visée à l’article 86, § 1er, ou étaient reconnus incapables de travailler au sens de la présente loi coordonnée.
(4) Tous les chiffres sur le profil des futurs exclus viennent de la présentation PowerPoint faite au comité de gestion de l’ONEm du 19 juin 2025.
(5) Lire sur le site de Dockers asbl la FAQ sur le travail des arts.
(6) Lire pour les détails de cette question, sur le site de Dockers asbl, les articles d’Anne-Catherine Lacroix « Réforme de l’assurance chômage : Vous percevez des allocations de chômage ? Faites valoir vos droits ! » et « Réforme de l’assurance chômage : Vous percevez des allocations d’insertion ? Faites valoir vos droits ! ».